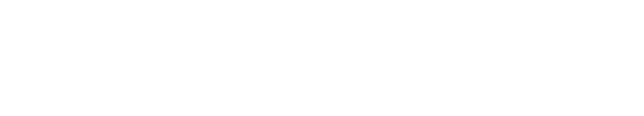L’article « De Santiago à Paris, les peuples dans la rue », a été publié en janvier 2020 par Serge Halimi dans le journal Le Monde Diplomatique. L’auteur y explique les causes des différentes vagues récentes de protestation ainsi que leurs conséquences sur la situation actuelle comme sur l’avenir.
Les rues ne désemplissent pas. Le mécontentement général et les manifestations qui en découlent (Algérie, Liban, Equateur, France, Chili…) prennent un nouveau tournant. On assiste à des mouvements collectifs très exigeants, solidaires et apolitiques qui ont porté quelques fruits. De plus en plus répressifs, les gouvernements peinent à faire taire leurs opposants qui « veulent la chute du régime ».
Tout a commencé en 2010, après le premier soulèvement tunisien qui a donné naissance aux printemps arabes. S’en sont suivis le « mouvement des places espagnoles », la mobilisation des étudiants chiliens et Occupy Wall street, pour n’en nommer que quelques-uns.
Aujourd’hui encore, aux quatre coins du monde, les slogans diffèrent mais on retrouve le même élément déclencheur: Une impuissance face au libéralisme économique qui creuse les inégalités sociales et face à l’oligarchie dominante en place qui ne répond pas aux besoins, ni ne représente les intérêts du peuple. Il en résulte une fatigue de vivre dans la précarité, de voir ses droits (retraite, éducation, santé) mutilés, son environnement dégradé. L’écologie illustre bien cette impuissance. Malgré les bonnes volontés politiques apparentes (particulièrement mises en avant lors des différentes COP), les plus riches continuent de surconsommer au détriment d’une planète en surchauffe.
Il y a plus de vingt ans, « la mort du capitalisme, la convergence des luttes, l’impasse de la mondialisation » nous étaient déjà annoncés. Pourtant, les politiques néolibérales n’ont cessé de se propager. Au cœur du problème, la corruption que l’on retrouve sous différentes formes: Celle qui consiste à financer des intérêts privés par la destruction du système public à coup de réformes (avec des programmes sociaux amputés, des services initialement publics de plus en plus chers, la mise en place de systèmes de retraite par capitalisation…); celle mise en évidence par des relations incestueuses entre l’Etat et le capital (par exemple, l’ancien président de la commission européenne, José Manuel Barroso, désormais employé par la banque Goldman Sachs) qui freinent le pouvoir des opposants au système économique établi.
Halimi présente le Chili, « berceau du capitalisme », comme la preuve même de son échec. Depuis octobre dernier, une grande partie de la population chilienne déplore son système politique resté néolibéral malgré la chute du régime totalitaire de Pinochet et la transition démocratique qui s’en est suivie: retraites par capitalisation, universités privés, autoroute et eau payantes. Malgré le durcissement de la répression policière, judiciaire et militaire (qui s’est soldée par 11 000 blessés, 200 éborgnés et 26 morts depuis le début de la crise sociale), la rébellion perdure.
Ces différentes protestations n’ont peut-être pas débouché sur une alternative politique sérieuse au néolibéralisme mais se sont tout de même soldées par de petites victoires qui suffiraient à renforcer la confiance des manifestants « plus forts » et « plus dignes »: le régime d’Omar El-Béchir est tombé au Soudan, des premiers ministres ont été forcés de démissionner au Liban et en Iraq, l’ancien président Bouteflika a été contraint de démissionner en Algérie et il est prévu que la constitution chilienne soit réécrite. Selon Halimi, ces manifestations auront en tout cas permis de « ne plus offrir au libéralisme l’espoir d’un retour à la normale ».