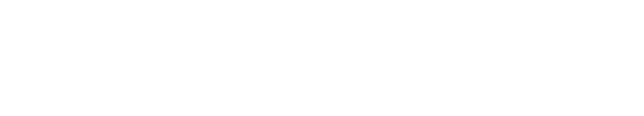En 2017, de nombreux Rohingyas fuyant les persécutions au Myanmar ont trouvé refuge au Bangladesh. Depuis, la Croix-Rouge Suisse (CRS), implantée dans la région depuis près de 50 ans, est également présente à Cox’s Bazar. Benedikt Kaelin, responsable du programme de la CRS pour le Bangladesh, décrit dans cette interview le quotidien des camps et résume les perspectives qui s’offrent aux réfugiés.
Cela fait maintenant deux ans que les Rohingyas ont fui leur pays. Quelle est aujourd’hui la situation dans les camps?
Actuellement, les camps abritent près d’un million de personnes, dont plus de 700 000 arrivées lors des événements d’août 2017. Certaines étaient là avant cette date, mais la plupart ont migré après cet épisode. Les campements sont gigantesques. On a parfois l’impression d’être dans de véritables villes, même si le gouvernement local veille à ce qu’aucune infrastructure pérenne ne se développe. La promiscuité est très forte. Dans certaines parties du camp, un individu dispose d’environ 10 m2, là où les standards humanitaires en prévoient plutôt 30 à 45. Les problèmes d’hygiène sont également importants.
Dans l’ensemble, la situation s’est améliorée depuis deux ans. Les besoins de base et les soins de santé sont ainsi bien mieux satisfaits qu’au début. Le gouvernement et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont fourni des papiers spéciaux à 500 000 personnes et de nombreux enfants vont à l’école pour la première fois de leur vie. De même, les organisations humanitaires ont sensiblement amélioré leurs structures, et se coordonnent nettement mieux.
En revanche, les perspectives d’avenir restent inexistantes, et ce problème ne semble pas devoir s’arranger. Les réfugiés, dont beaucoup ont vécu des expériences traumatisantes, n’ont pas accès au marché du travail formel et dépendent donc de l’aide humanitaire. La conjonction de ces difficultés ne fait qu’aggraver le désespoir, entraînant des mécanismes de violence délétères.
Par ailleurs, les tensions s’exacerbent – à l’intérieur des camps, mais aussi entre les réfugiés et la population locale. De fait, les camps mobilisent de nombreuses ressources et de larges terrains qui, avant, revenaient aux locaux. Sans compter que l’afflux de population a provoqué une hausse des prix. Aussi, lorsque de jeunes déplacés ont été accusés du meurtre d’un responsable politique de la région survenu fin août 2019, la population locale a réagi avec beaucoup d’hostilité.
Comment se fait-il que les tensions et la violence augmentent alors même que les conditions de vie dans les camps se sont améliorées dans de nombreux domaines?
En ce qui concerne la violence, il s’agit pour le moment de cas isolés. Je ne discerne encore aucun schéma suggérant qu’elle est en hausse au sein même des camps. Mais lorsque tant de personnes cohabitent dans des conditions aussi précaires, une certaine forme de violence et de criminalité me paraît inévitable. Ce qui est en revanche incontestable, c’est que les tensions entre la population locale et les réfugiés s’aggravent.
Comment l’expliquer? Il y a d’un côté, de nombreuses attentes qui sont restées insatisfaites, de l’autre les ressources qui, on l’a vu, se raréfient… Ces gigantesques camps introduisent aussi dans l’économie locale des distorsions qui, évidemment, profitent à certains. Je pense notamment à des entreprises de transports et d’hébergements ou aux personnes qui ont été embauchées par les organisations internationales. Il est par ailleurs de plus en plus clair que la crise risque de se prolonger indéfiniment. Tout cela engendre une grande frustration dans certains segments de la population.
La population locale et les habitants des camps vivent-ils à proximité les uns des autres? Se voient-ils quotidiennement?
Oui, toutes ces personnes sont en contact quotidien et vivent dans la promiscuité. Il y a bien sûr des points de contrôle à l’entrée des camps, mais ces derniers sont répartis sur un immense territoire qui abrite un peu partout des communautés locales. Bien souvent, les contacts sont très positifs. Ils donnent lieu à des discussions animées lorsque les gens se rencontrent au marché. Et ils ont fait émerger de véritables chaînes logistiques qui permettent d’améliorer le fonctionnement des marchés du camp.
Tu nous as dit que les réfugiés des camps n’avaient pas le droit de travailler. Comment occupent-ils leurs journées?
Ils n’ont pas le droit de travailler de manière formelle, mais ils peuvent effectuer des tâches ne requérant aucune qualification et parfois même rémunérées. Certains gagnent un peu d’argent en travaillant auprès des organisations humanitaires. Ce genre d’opportunités est largement recherché, notamment par les hommes, qui souffrent de l’inactivité forcée. Dans la journée, on les voit souvent sur la place du marché, en quête d’une source de revenus. Les femmes restent plutôt au logis à s’occuper de leur famille.
Quels services la CRS assure-t-elle sur place?
La Croix-Rouge suisse se base sur les besoins existants mais elle agit principalement dans le domaine de la santé, où elle a une expertise à faire valoir. Il faut cependant bien distinguer le rôle qu’elle a joué lors de l’éclatement de la crise, en apportant une aide d’urgence, de celui qu’elle assume actuellement, dans une perspective de plus long terme. Au tout début, les actions se sont concentrées sur la construction de fontaines et de latrines, assortie de formations sur l’hygiène. En 2018, trois centres sanitaires multifonctionnels ont été construits. C’est là que la CRS, en collaboration avec des organisations partenaires, peut aujourd’hui proposer des services axés sur la santé et la nutrition, favoriser le regroupement familial et mener un travail de prévention mettant l’accent sur le planning familial, la vaccination et les mesures d’hygiène. Notre organisme propose également un accompagnement psychosocial. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont bénéficié de ces prestations.
Actuellement, la CRS participe à la construction de deux centres sanitaires supplémentaires, ce qui l’amène à collaborer étroitement avec divers acteurs, dont le ministère de la santé. Les centres sanitaires de la Croix-Rouge sont coordonnés de manière très spécifique, car tous les acteurs (ONG, organismes des Nations Unies et médecins du gouvernement) travaillent dans un même lieu. Autre particularité: ils sont construits dans un matériau spécifique qui les rend semi-permanents. Ils ne sont bien sûr pas conçus pour durer – le gouvernement local ne l’aurait pas accepté – mais ils sont plus résistants que les autres bâtiments.
Enfin, dans un des camps, la CRS est en train de mettre sur pied un système de gestion des déchets.
Quels sont les principaux défis du travail sur le terrain?
En tant que membre de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la CRS s’efforce de travailler avec les sociétés locales de la Croix-Rouge dans ses pays programmes. À Cox’s Bazar, il s’agit du Croissant-Rouge du Bangladesh. Comme beaucoup d’organisations, celui-ci n’était pas préparé aux événements inhabituels qui ont touché la région. La CRS, avec ses projets, épaule les structures des organisations partenaires. Cela ne va pas sans difficulté: nos partenaires sont par exemple incapables de concurrencer le niveau de salaire offert par d’autres organisations à leurs employés locaux, ce qui, en retour, complique le recrutement de personnes compétentes pour l’exécution de tâches exigeantes.
La disponibilités des médecins gouvernementaux pose également problème. Le voyage jusqu’aux camps, notamment, peut être particulièrement pénible pendant la saison des pluies, ce qui entraîne régulièrement des défections.
Comment s’organise la collaboration avec le gouvernement bangladais?
Le gouvernement s’est montré et se montre encore très généreux dans la prise en charge des réfugiés. La CRS et les autorités collaborent dans l’ensemble de façon harmonieuse. Pour citer un exemple concret, un accord a récemment été signé avec le ministère de la santé, dans lequel les parties impliquées ont défini les rôles et les responsabilités de chacun et se sont engagées à travailler ensemble de manière constructive.
Mais en tant que pays d’accueil, le Bangladesh est confronté à d’immenses défis. C’est un pays très peuplé, qui doit lui-même satisfaire les gros besoins de ses 160 millions d’habitants. Les camps de réfugiés constituent une charge supplémentaire.
Le gouvernement ne souhaite absolument pas voir les réfugiés s’installer durablement à Cox’s Bazar. Il envisage d’ailleurs de les déplacer sur une île isolée. Le projet prend doucement forme, mais il ne concernerait qu’une partie des réfugiés – environ 150 000 personnes. Selon le gouvernement, le déplacement doit être proposé en priorité aux individus particulièrement exposés au risque de catastrophes naturelles.
Peux-tu nous en dire plus sur ces catastrophes naturelles? La menace est-elle réelle?
Le Bangladesh est régulièrement frappé par de tels phénomènes, en particulier par la mousson qui, cette année encore, a occasionné de gros dégâts. Les camps ont été inondés d’avril à septembre. L’accès aux soins en a été compliqué, près de 15 000 personnes ont dû être évacuées et de nombreux logements ont été endommagés ou détruits. Il faut dire que les campements sont construits sur des pentes et donc très exposés aux glissements de terrain. Heureusement, cette année, aucun décès n’a été déploré, grâce entre autres aux mesures de sécurité adaptées.
Les camps sont bien préparés aux petits événements de ce genre. En revanche, si un cyclone se déclarait dans la région, les conséquences seraient imprévisibles.
Quelles sont les perspectives d’évolution?
Il y a trois scénarios possibles: le rapatriement des réfugiés au Myanmar, le déplacement, ou l’installation durable avec intégration à la population de Cox’s Bazar. On l’a dit, le gouvernement ne veut pas entendre parler de la troisième option.
Pour le rapatriement, des discussions sont en cours, mais les pays impliqués et les Nations Unies campent sur des positions très différentes. En outre, à ce jour, aucun réfugié n’a déclaré consentir librement à retourner au Myanmar. Il faudrait des garanties solides concernant leur sécurité et leurs conditions de vie dans ce pays qu’ils ont fui.
Reste le déplacement sur le territoire bangladais: 150 000 personnes pourraient peut-être bénéficier effectivement de cette solution, mais ce n’est qu’une petite fraction de la population à prendre en charge. Le sort des autres, lui, demeurerait incertain.